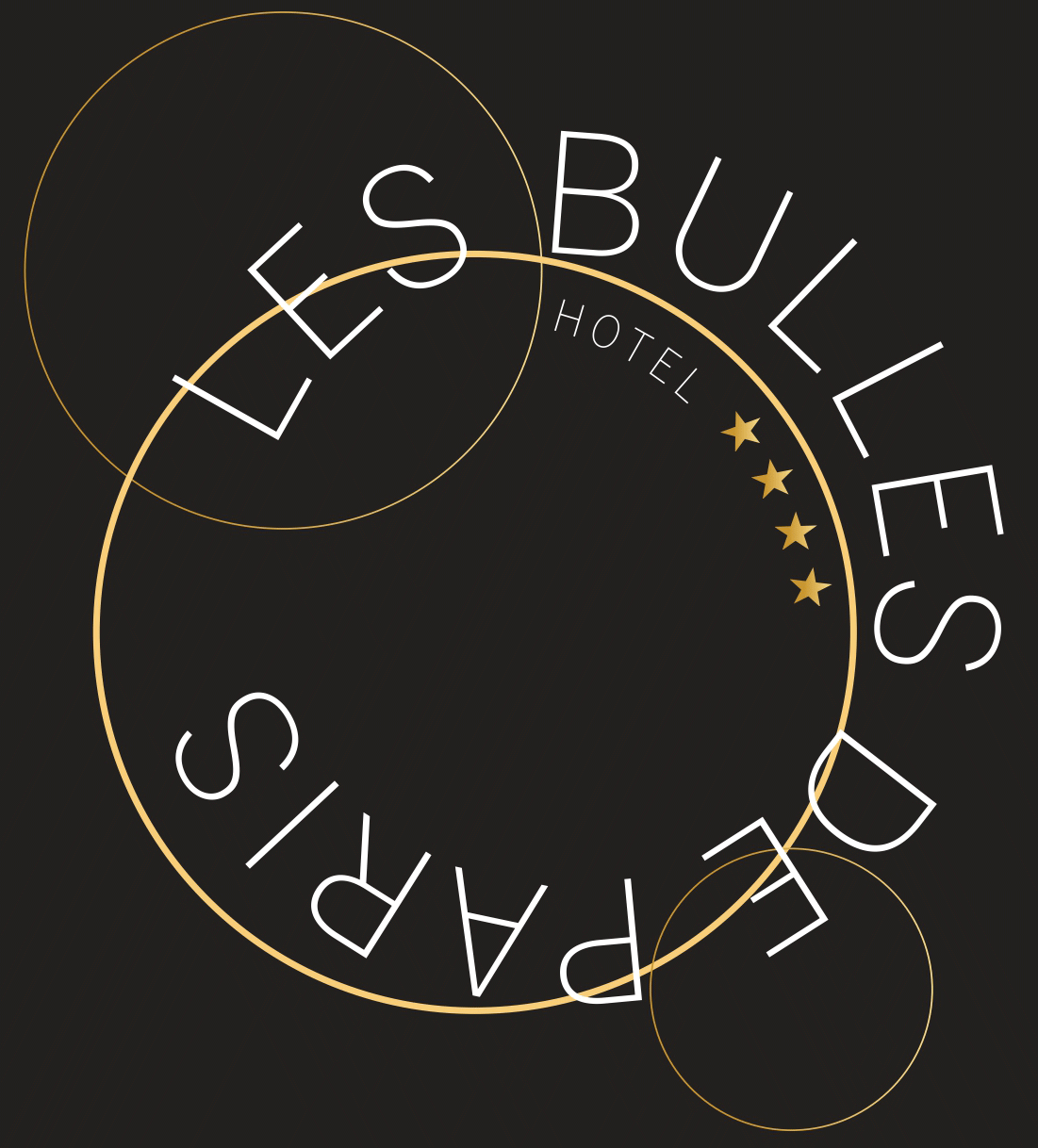Environs
A découvrir à proximité de l'hôtel
Situé au cœur du Quartier Latin, notre hôtel 4 étoiles vous offre un accès en seulement quelques minutes à pied des lieux incontournables à découvrir lors de votre séjour.
Plongez tout d’abord dans l’histoire et l’architecture de la Cathédrale de Notre-Dame, située à seulement quelques pas de notre hôtel.
Partez explorer les rues pavées et les places animées du Quartier Latin, symbole de l’histoire et de la culture parisiennes. Ne manquez pas les Arènes de Lutèce et la Grande Mosquée de Paris, témoins de l’héritage riche et diversifié de ce quartier emblématique.
Les salles de spectacles à Paris sont nombreuses et accueillent une grande diversité de représentations : théâtre classique ou contemporain, concerts, opéra, stand-up… Tous les soirs, Paris vous offre une foule d’idées de sorties !
Tout proche, le Panthéon domine le Quartier Latin et offre une vue panoramique sur la capitale. A quelques encablures de l’hôtel, vous pourrez rejoindre le quartier de la Contrescarpe et la légendaire rue Mouffetard ou, au contraire descendre vers le Boulevard Saint-Michel pour profiter des Jardins du Luxembourg.
Véritable havre de paix au cœur de la ville, vous y flânerez le long des allées ombragées ou vous y détendrez au bord du bassin central. Aux beaux jours, profitez aussi des nombreuses activités proposées, des concerts en plein air aux séances de yoga. Beaucoup de parisiens s’y retrouvent également pour y courir dès le petit matin.
Les idées ne manquent pas, et il suffit souvent de suivre la Seine au rythme de ses ponts pour partir à la rencontre des hauts lieux touristiques de Paris, jusqu’à la Tour Eiffel. Notre hôtel se trouve à l’épicentre de la capitale et nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller les meilleurs itinéraires de visite.